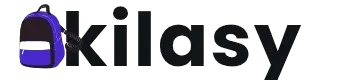Face aux déséquilibres du marché du travail, les pouvoirs publics mettent en place diverses politiques de l’emploi visant à réduire le chômage et améliorer le fonctionnement du marché. Ces politiques reposent sur des diagnostics différents des causes du chômage.
Le chômage se définit comme la situation des personnes sans emploi, disponibles pour travailler et recherchant activement un emploi. On distingue plusieurs types de chômage :
- Le chômage frictionnel : lié au temps nécessaire pour trouver un emploi correspondant à ses compétences
- Le chômage conjoncturel : dû à une insuffisance de la demande globale
- Le chômage structurel : résultant d’une inadéquation entre offre et demande de travail
- Le chômage technologique : causé par le progrès technique qui rend certaines compétences obsolètes
Les politiques de l’emploi peuvent être classées en deux grandes catégories :
1. Les politiques passives 🛡️ : Elles visent à indemniser les chômeurs et à les accompagner dans leur recherche. Exemples : allocations chômage, accompagnement personnalisé, aides au retour à l’emploi.
2. Les politiques actives ⚡ : Elles cherchent à agir directement sur le niveau d’emploi :
- Les politiques de demande (keynésiennes) : relance par la dépense publique, investissements infrastructurels
- Les politiques de l’offre (néoclassiques) : baisse des charges sociales, flexibilisation du marché, formation des chômeurs
- Les politiques de matching : amélioration du fonctionnement du marché (Pôle Emploi, sites de recrutement)
La France a développé de nombreux dispositifs comme les aides à l’embauche (ex: réductions de charges sur les bas salaires), la formation professionnelle (CPF), ou encore les contrats aidés qui subventionnent l’embauche de certaines catégories de chômeurs.
Un débat important oppose les partisans de la flexisécurité (à la danoise) qui combine flexibilité pour les entreprises et sécurité pour les travailleurs, et les défenseurs d’une protection plus forte de l’emploi stable.
Les politiques de formation sont cruciales pour lutter contre le chômage structurel. En adaptant les compétences aux besoins des entreprises, on réduit les inadéquations. Par exemple, former davantage de personnes aux métiers du numérique répond à une demande croissante.
Enfin, face aux transformations du travail (ubérisation, télétravail, IA), les politiques de l’emploi doivent constamment s’adapter. Le défi est de concilier flexibilité pour les entreprises et protection des travailleurs dans un monde du travail en mutation rapide.
🌟 Pour retenir : Les politiques de l’emploi reflètent les conceptions économiques dominantes. Après 1945, les politiques keynésiennes dominaient, alors qu’à partir des années 1980, les politiques inspirées du néoclassicisme (flexibilité, baisse des coûts du travail) se sont développées.