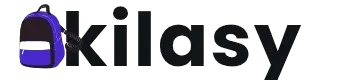Depuis l’indépendance, Madagascar a connu plusieurs orientations économiques, chacune influencée par le régime politique en place et les conjonctures internationales. 📊
1. L’économie post-coloniale (1960-1972)
Durant la Première République, l’économie reste fortement liée à la France. Les exportations principales concernent la vanille, le café, et le clou de girofle. Cette dépendance aux produits agricoles expose le pays aux fluctuations des cours mondiaux.
2. Le virage socialiste (1975-1980)
Sous Didier Ratsiraka, l’État prend le contrôle des secteurs stratégiques : banques, entreprises, commerce extérieur. La Charte de la Révolution Socialiste favorise la nationalisation. Cependant, cette politique entraîne des difficultés : baisse de productivité, désorganisation du marché et endettement.
3. L’ajustement structurel (1980-1990)
Face à la crise, Madagascar adopte les programmes d’ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Ces réformes libéralisent l’économie : privatisations, réduction des subventions, ouverture au commerce international. Si elles stabilisent partiellement les finances publiques, elles aggravent la pauvreté.
4. La libéralisation et la croissance fragile (1990-2000)
L’ouverture attire de nouveaux investisseurs, notamment dans le textile (zones franches industrielles dès 1989). Mais la croissance est irrégulière, dépendante des crises politiques (exemple : blocage économique en 2002).
5. Depuis 2010 : diversification et défis persistants
Avec la Quatrième République, Madagascar tente de diversifier son économie : exploitation minière (nickel, cobalt, ilmenite), développement du tourisme et essor des NTIC. Cependant, l’agriculture de subsistance reste dominante et la pauvreté touche encore plus de 70 % de la population.
Astuce mnémotechnique : Retenir les 5 grandes phases avec l’acronyme « S.A.L.L.D » : Socialisme – Ajustement – Libéralisation – Liens avec la France – Diversification. ✅