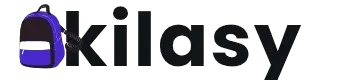Depuis la fin de la guerre froide, les conflits ont pris des formes variées : conflits interétatiques, guerres civiles, crises humanitaires et menaces transnationales (terrorisme, cyberattaques). Cette leçon examine les principaux foyers de tensions, les dates marquantes et les enjeux géopolitiques associés.
1. Les conflits des années 1990 : fragmentation et interventions
La chute du bloc soviétique a libéré des tensions latentes :
- 1992-1995 (Bosnie) : guerre ethnique, siège de Sarajevo, accords de Dayton (1995) qui illustrent l’intervention diplomatique-militaire pour mettre fin aux conflits.
- 1994 (Rwanda) : génocide — un exemple tragique de l’échec des institutions internationales à prévenir une violence de masse.
2. Terrorisme et « guerre contre le terrorisme »
Les attentats du 11 septembre 2001 sont un point d’inflexion : ils entraînent les interventions en Afghanistan (2001) et en Irak (2003) et modifient les priorités de sécurité internationale :
- Les concepts de sécurité nationale et lutte antiterroriste deviennent centraux.
- Apparaissent des débats sur les droits de l’homme, la détention (ex. Guantánamo) et la légitimité des interventions préventives.
3. Conflits régionaux récents et caractéristiques
Les conflits récents (années 2010-2020) montrent la complexité géopolitique :
- 2011-2012 (Printemps arabe) : révoltes et transitions, comme en Tunisie, Égypte, Libye — conséquences variables et parfois état de fragilité durable (ex. Libye).
- 2014 : crise en Ukraine — annexion de la Crimée par la Russie et guerre dans l’est de l’Ukraine, illustrant la nouvelle confrontation entre puissances.
- Conflit israélo-palestinien : cycles de violence réguliers et enjeux internationaux persistants.
4. Enjeux géopolitiques majeurs
Plusieurs enjeux structurent la scène internationale :
- Contrôle des ressources : énergie, eau, matières premières — motifs de rivalité entre États. Par exemple, l’importance stratégique du Golfe persique.
- Routes commerciales : points de passage (détroits, mers) et sécurité maritime — la montée en puissance chinoise rend la sécurité des routes maritimes cruciale.
- Technologie et cybersécurité : compétition pour la supériorité technologique (5G, intelligence artificielle).
5. Conséquences humanitaires et réponse internationale
Les conflits entraînent déplacements de populations (réfugiés), crises humanitaires et besoin d’intervention (assistance, maintien de la paix). Des dates et chiffres importants sont à connaître lors des études de cas : ex. exode rwandais 1994, crises syriennes après 2011.
6. Exemples d’analyse : application à un cas concret
Prends la crise ukrainienne (2014 puis intensification en 2022). Analyse :
- Les causes : héritage post-soviétique, choix géopolitique pro-occidental de certains États, enjeux identitaires.
- Les acteurs : Russie, UE, États-Unis, OTAN, populations locales.
- Les moyens : sanctions économiques, action militaire, campagnes d’information, diplomatie.
7. Astuce mnémotechnique 🧠
Pour retenir les foyers et dates : associe chaque décennie à un type de conflit : 1990s = fragmentation et guerres civiles; 2000s = terrorisme et guerres d’intervention; 2010s = révoltes populaires et affrontements interétatiques; 2020s = rivalités technologiques et géopolitiques intensifiées.
Comprendre les nouveaux conflits, c’est savoir relier événements et causes profondes (identités, ressources, technologie). Retenir les dates clés et les mécanismes d’intervention internationale est essentiel pour analyser la géopolitique contemporaine.